« Les gens ignorent trop qu’ils ont le pouvoir sur la langue »
Dans le contexte de crise actuelle liée à l’épidémie de coronavirus, votre revue a décidé de mettre chaque jour en ligne, depuis le 20 mars – journée de célébration de la francophonie – et tous les jours à midi, un article du « Français dans le monde » en libre accès. Aujourd’hui, l’entretien de notre rubrique « Langue » avec Maria Candea, co-autrice de l’ouvrage Le français est à nous ! (éd. La Découverte). Un article à retrouver dans le numéro 425 de septembre-octobre 2019. Bonne lecture (et bon courage) à toutes et tous !
Propos recueillis par Clément Balta
Maria Candea est docteure en linguistique française, maîtresse de conférences à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Elle est également cofondatrice et membre du comité de rédaction de la revue GLAD! consacrée aux recherches sur le langage, le genre et les sexualités.

Co-autrice avec Laélia Véron de l’ouvrrage Le français est à nous !, Maria Candea soutient une « émancipation linguistique » qu’elle estime nécessaire, notamment dans une société française souvent trop conservatrice et un enseignement de la langue trop normatif.
Quel est ce « nous » dont vous parlez dans le titre de votre ouvrage ?
Il est fait pour intriguer, pour être ambigu. Il peut être exclusif, mais il est évidemment inclusif, c’est en fait le contraire du possessif utilisé par Jean-Michel Delacomptée dans son livre Notre langue française (voir entretien dans FDLM 420). La langue n’appartient à personne et disparaît quand on cesse de s’en emparer. Elle est à tous ceux qui la pratiquent. Il s’agissait donc pour nous de dire : non seulement elle est à nous, mais elle n’existe que grâce à nous. C’est une prise de pouvoir consciente, mais les gens ignorent trop qu’ils ont ce pouvoir.
C’est le sens de votre sous-titre qui désigne votre livre comme un « manuel d’émancipation linguistique » ?
C’est une porte d’entrée, des pistes de réflexion pour se faire son propre avis. C’est pourquoi il y a une bibliographie commentée à la fin de chaque chapitre. On manque terriblement de culture générale sur la langue. On a soit l’impression que tous les avis se valent, soit que seule l’Académie française est pertinente. Mes étudiants de première année pensent même que c’est elle qui fait les dictionnaires… Alors que le dernier qu’elle ait publié date de 1935 ! On donne donc des repères : comment on a modifié notre attitude par rapport à la langue, à la maîtrise de l’écrit, à l’homogénéité du français (cet idéal de français unique étant très tardif), à quel moment on s’est mis à confondre la langue et l’orthographe et la fétichisation de celle-ci… Afin, en effet, de s’émanciper de ceux qui disent avoir le pouvoir de donner les normes en matière de langue, de légiférer et de contrôler, et qui mettent sous le tapis le pouvoir de l’usage, le seul qui en définitive fait vraiment changer la langue. Ce n’est donc pas donner le pouvoir, puisque nous l’avons, mais prendre conscience de notre marge d’action, de la puissance d’agir qu’on a quand on utilise une langue.
Concernant l’orthographe, vous avez écrit tout un passage en « ortografe » simplifiée. Dans quel but ?
Rappelons déjà que l’orthographe s’est toujours rapprochée de la prononciation. L’oral évolue tout le temps, alors que l’écrit progresse par à-coups. Quand l’Académie a décidé de la première orthographe qu’on ait eue, les gens écrivaient depuis longtemps le français. Molière n’avait pas d’orthographe, la notion n’existait pas ! Il n’avait pas de dictionnaire non plus. Parler de « langue de Molière », c’est assez amusant vu qu’on n’avait aucune idée de comment il écrivait… C’était plutôt une demande d’imprimeur et non d’écrivains de trouver une norme. Mais le choix initial était tellement élitiste et aberrant qu’il a fallu rationnaliser petit à petit avec des réformes. Mais la dernière date de 1835 ! On s’est arrêté quand l’enseignement s’est démocratisé. Ce qui était une très bonne chose, mais on a dû former plein d’instituteurs à la va-vite, qui n’étaient ni lettrés ni latinistes. Ila fallu inventer une façon d’enseigner l’orthographe pour l’accès à l’écrit. On l’a alors figée, sans donne les clés critiques pour la comprendre. Ça a changé tout le rapport à la langue. C’est comme ça qu’on a créé la grammaire scolaire, qui linguistiquement était une sorte de monstre, juste pour enseigner l’orthographe.
« Le discours dominant de ceux qui maîtrisent la langue c’est : le niveau baisse. Ils dénoncent le niveau en orthographe et non le fait qu’il y a moins de profs et moins d’heures de français ! »
Quel parallèle peut-on faire avec la situation de l’enseignement du français aujourd’hui ?
Le discours dominant de ceux qui maîtrisent la langue c’est : le niveau baisse. Ils se scandalisent sur l’orthographe alors qu’il y a moins de profs et moins d’heures de français ! D’où la nécessité, toujours, de réformer. Cela avait déjà failli se faire juste avant la Première Guerre mondiale. La modernité des textes de 1910 que j’ai lus sur le sujet… Notamment sur la nécessité d’une orthographe plus rapide et simple à enseigner, afin que les classes populaires puissent accéder plus vite à des choses plus complexes. On en est toujours là un siècle après ! Il faut donc réfléchir et s’emparer de ces questions collectivement – et politiquement. C’est pourquoi on veut donner des outils : tout le monde peut avoir un avis et peser politiquement sur ces choix-là.
Les enseignants ne sont-ils pas au premier rang de cette nécessité de réforme dont vous parlez ?
À vrai dire, les profs étaient déjà prêts lors de la réforme de 1990. Des enquêtes prouvaient qu’en grande majorité, et dans toute la francophonie, ils étaient pour enlever les lettres grecques (le « th » ou le « ph » comme dans… orthographe), les anomalies sur les doubles consonnes et l’accent circonflexe… Mais les rectifications ont finalement été timides, à cause d’une tradition ultraconservatrice et démagogique qui veut que toucher à l’orthographe met en danger la langue elle-même. Alors que tout un accompagnement avait été préparé, des guides explicatifs sur la réforme, des sites Internet, pour leur application généralisée, tout ça a été saboté, et on a encore perdu 25 ans.
N’est-ce pas la même chose concernant l’écriture inclusive que vous abordez ?
Les gens sont souvent contre ce qu’ils ne comprennent pas et ne connaissent pas. C’est très facile, et très vendeur, de faire peur en matière de langue. Et ça contribue à ce sentiment d’insécurité linguistique comme quoi le français est une langue difficile et élitiste. Concernant la féminisation, nous montrons à quel point il s’agit en fait de « démasculiniser » la langue. Et ça n’a rien de nouveau : il y avait déjà des débats très virulents à ce sujet dans les années 80, sur les noms de métier, sur l’idée que le masculin serait neutre, que dire « la ministre » ce serait moche… Avec l’écriture inclusive, les polémiques reprennent. Qu’on utilise le point médian ou le trait d’union, on verra, mais le fait d’étendre le domaine de l’accord en genre, c’est une tendance amorcée il y a déjà 40 ans.
Donc, selon vous, le français ne serait pas en danger, malgré certains discours alarmistes ?
Les francophones n’ont jamais été aussi nombreux (300 millions selon les dernières estimations). C’est indécent de parler de langue en danger alors qu’il y en a tant qui disparaissent partout dans le monde. En revanche, que l’influence ou la valeur du français sur le marché des langues mondiales diminue, c’est tout à fait possible. C’est lié à des questions géopolitiques. Certains pays de la Francophonie peuvent favoriser un élargissement du domaine d’apprentissage du français et d’autres passer au contraire à des langues en concurrence, comme le Rwanda avec l’anglais. Mais quand la France fait augmenter les droits des étudiants étrangers, cela touche directement les étudiants francophones d’Afrique, et ce n’est pas ce que j’appelle une politique de soutien à la francophonie ! À Paris 3, cela a divisé le nombre de candidatures par trois…
« Le besoin d’émancipation prend un sens particulier en Afrique francophone. Il y a aura un jour une renégociation du pouvoir par rapport à la définition de la norme du français »
L’émancipation linguistique reste à faire en Afrique francophone, selon vous ?
Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’office de la langue en Afrique. Le Québec a créé le sien, la Belgique aussi, la Suisse possède une Délégation à la langue française. Ça viendra peut-être dans les pays africains francophones, où la situation est complexe et liée évidemment à une histoire coloniale. Le choix du français n’est jamais acquis et se fait parmi d’autres langues. La France défend beaucoup le plurilinguisme à l’international, mais pas à l’intérieur de ses frontières, c’est une contradiction difficile à tenir… Il y a aussi une longue tradition française de dévalorisation des locuteurs noirs sur laquelle nous revenons, avec le « Y a bon Banania » et le « petit nègre », qui génère là aussi un fort sentiment d’insécurité linguistique. Inversement, des élites africaines se font plus puristes que l’Académie pour prouver leur maîtrise de la langue, le moindre écart étant vécu comme un soupçon d’infériorité symbolique. D’où ce besoin d’émancipation. Je pense qu’à un moment donné il y a aura une reprise de pouvoir par rapport à la définition de la norme du français.
Justement, comment voyez-vous l’avenir du français ?
En soi, si je devais me montrer provocante, je dirais qu’on pourrait très bien se passer du français. Tant de langues ont disparu, et l’humanité n’a pas cessé d’en créer et de les transmettre… D’un point de vue linguistique, tout est possible. On peut se diriger vers une langue unique ou au contraire vers un enseignement plurilingue dès la petite enfance, comme au Luxembourg. Sans parler qu’on pourra sans doute bientôt communiquer entre nous par l’intermédiaire de machines de plus en plus performantes, sans besoin d’apprendre les langues. C’est pour ça qu’il est important d’y réfléchir, de se faire son opion et de se positionner sur la langue.
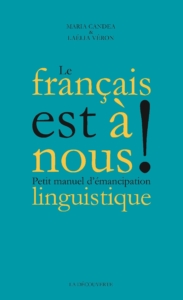
Maria CANDEA et Laélia VÉRON, « Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique », éditions de La Découverte, 2019.



